Supernova, L’Amour au temps du terrorisme, notre élule d’avril, narre les temps troublés qui ont suivi le Printemps arabe en Tunisie. L’auteure, Gihèn Ben Mahmoud, nous a détaillé comment son projet de docu-fiction a pris forme…
Une famille au cœur de la « révolution »
Qu’est ce qui a déclenché le processus de création de Supernova ?
Depuis la « révolution tunisienne », je voulais écrire quelque chose. Mais il m’a fallut du temps pour digérer les choses, en faire quelque chose de décent. Après le printemps arabe, il y a eu beaucoup de publications sur le sujet, sans forcément de recul. Je ne voulais pas me mêler à ça : il faut du temps pour réfléchir à ce qui s’est passé, surtout quand ça nous touche.

Je n’arrivais pas à exprimer l’accumulation de tout ce qui s’est passé en Tunisie, dont je suis originaire et où j’ai grandi. En 2012, un ami passionné d’astronomie m’a expliqué ce qu’est une supernova. Avec cet évènement, j’ai trouvé la forme pour narrer mon histoire sur la Tunisie : les deux éléments se sont connectés et à partir de ce moment là, l’histoire a coulé toute seule. Comme si tout ce que j’avais retenu avait pris enfin forme !
L’idée que j’ai eue à partir du titre était très générale : mon récit fait un parallèle entre la naissance d’une étoile, le parcours du personnage principal, Shams, et aussi du pays. J’ai essayé de construire le récit en partant de ce symbole.

Avez-vous changé des choses dans le récit suite à l’actualité ?
J’arrête le récit il y a deux ans environ, pour raconter surtout l’après « révolution ». Je voulais me focaliser sur la chute de Ben Ali, les problèmes qui ont suivi entre manifestations pro- islamistes, les problèmes au gouvernement. Bien sûr ça fait écho à ce qui se passe aujourd’hui : je ne parle pas directement de l’attentat qui s’est passé au musée Bardo mais mon histoire montre bien comment l’instabilité politique du pays et les tensions préparaient en quelque sorte un événement pareil.
Quel est le pilier de votre récit ?
L’histoire de la Tunisie est racontée à travers le destin d’enfants d’une même famille, de classe moyenne. Pour moi, c’est la famille moyenne classique tunisienne. C’est vraiment comme mes grands-parents et mes parents : des gens simples qui vivaient tranquillement. Le récit se concentre sur les choix que les enfants vont faire, notamment la plus jeune des filles, qui incarne vraiment la recherche d’identité liée à cette « révolution ».

Shams voit tous les changements du pays, des années 90 très laïques aux années 2010 avec le boom de l’islamisation du pays : beaucoup de choses ont changé et chacun les a vécu différemment. Elle va chercher sa place en fait. Je voulais montrer ce changement, cette quête d’identité. Une quête finalement très universelle.
Et les autres enfants ?
Le grand frère, ex-blogueur, détonne un peu dans cette famille de la classe moyenne. Il était contre le régime Ben Ali, a été emprisonné pendant la révolution et cela a déclenché quelque chose en lui. Il va entrer dans une sorte de secte ultra-religieuse suite à cela.
La sœur aînée devient très religieuse, à la suite d’une déception amoureuse. Elle a cherché des réponses à sa déception dans la religion, comme aurait pu le faire n’importe quelle personne, musulmane, catholique ou autre. Les gens cherchent Dieu dans les moments de détresse. Enfin, la deuxième fille est très rebelle, car étant très belle, elle fait tout pour avoir plus de liberté : elle cherche son bonheur en défiant la société conservatrice tunisienne.
Dialoguer surtout

Au premier plan, il y a l’amour…
L’amour est important à intégrer dans une histoire. Les récits sur les sentiments me parlent plus que les autres, c’est vraiment un moyen de capter l’attention des gens. Les deux personnages principaux, Shams et le journaliste américain qui veut couvrir les « événements », incarnent deux extrêmes qui se rencontrent.
Or cette rencontre a été très difficile à orchestrer : d’un côté, Shams, très intelligente, très pratiquante et très engagée dans un islam non politisé. Durant tout le récit, elle explique son parcours, de la laïcité à la recherche de religion. Et de l’autre le journaliste, qui incarne le regard extérieur sur la Tunisie.
Shams va être enlevée avec le journaliste par des terroristes : ils vont donc être obligés de se parler et comprendre l’autre. Le personnage de Shams me permet d’ailleurs de donner la parole aux femmes qui portent le voile. Souvent on les juge, pensant qu’elles sont obligées de le faire, alors que ce n’est pas forcément le cas. Elles ont le droit de faire les choix qui leur semblent en accord avec leurs croyances.
Pour moi, cette rencontre, c’est le terrain du dialogue nécessaire : comme ces personnages se parlent directement, ils lèvent pas mal de malentendus entre eux. C’est ma manière de faire discuter deux mondes avec du recul, de ne pas prendre parti !
Vous abordez aussi le face-à-face très tendu entre fanatisme et laïcité…
En Tunisie, on est au croisement entre le modèle laïque moderne proposé par Bourguiba et celui qui serait un « retour aux racines », lié à la religion, une manière de s’identifier facilement alors qu’un pays est en pleine mutation. Comme la Tunisie est à cheval entre l’Occident et l’Orient, il y a un besoin de se créer sa propre identité, en refusant de ressembler à l’autre, à cet Occident fantasmé. Comme c’est très difficile de se trouver, cette quête me semble primordiale et intéressante à raconter.

Il est facile de tomber dans les extrêmes quand on se construit contre quelque chose. J’aborde cette question notamment avec les phrases de la bande-annonce, qui sont toutes tirées de vrais discours « d’islamisation » ! Depuis 9 ans que je suis partie de la Tunisie, chaque année, quand je rentre, je retrouve un pays complètement changé !
Ça pousse à réfléchir car ces discours religieux ne sont pas diffusés uniquement en Tunisie. Ces prédicateurs très virulents d’Arabie Saoudite et du Quatar notamment sont suivis partout dans le monde. Certains tiennent des discours très choquants, notamment sur l’Art. J’avais besoin de faire ce livre pour informer aussi de ce qui se passe à ce niveau, vu que ça n’est pas souvent mis en avant dans les médias ici.
Pourquoi publier en français ?
Je publie en français et en italien, mais pas en arabe. Non par peur, mais parce que la BD n’est pas très répandue dans cette langue et que les Tunisiens intéressés pourront la lire en français très facilement. J’aimerais bien aussi la publier en anglais, mais pour l’instant je n’ai pas le support technique pour la traduction.

Pouquoi avoir choisi uniquement le rouge comme couleur ?
Le rouge est le thème du drapeau tunisien. Et surtout il me fallait quelque chose de simple pour cet album, de très différent de ce que j’ai fait avant. Je voulais un dessin simple et expressif au service de l’histoire.
Et où en êtes-vous dans la création ?
J’ai réalisé plus de 30 % du projet ! Le découpage est presque fini ! J’ai prévu de tout terminer fin 2015, car je veux être prête pour le festival d’Angoulême !


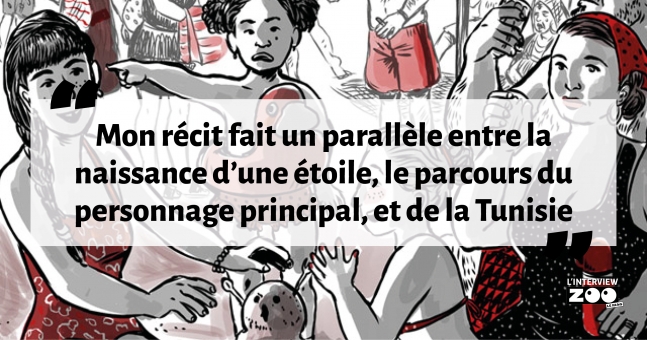



.png)
 Haut de page
Haut de page
Votre Avis